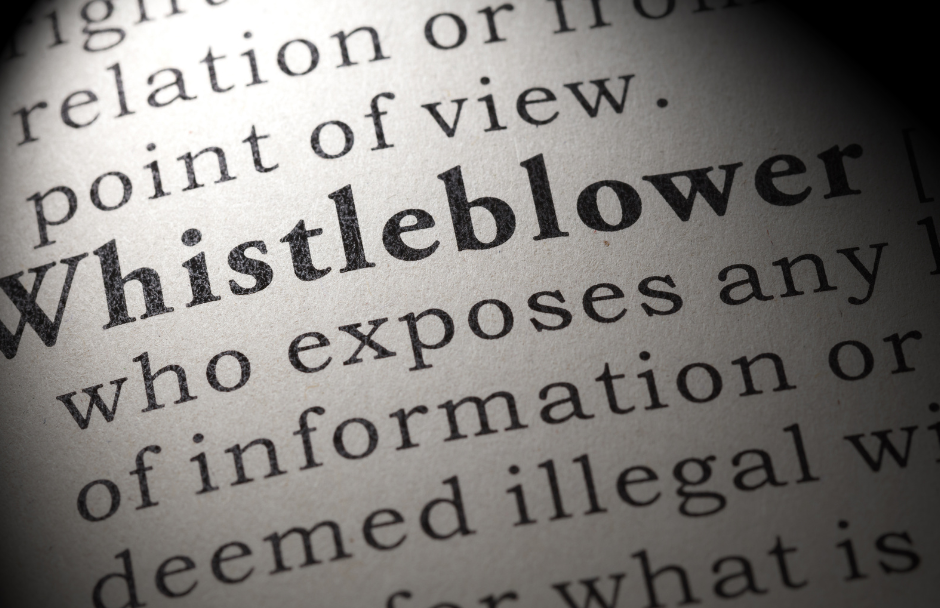Une avancée majeure dans le droit de la reconnaissance en France des praticiens à diplôme étranger

Une avancée majeure pour la reconnaissance en France des praticiens de santé à diplôme étranger reconnu dans un autre état membre – confirmation des principes de la jurisprudence Hocsman - L’administration est tenue d’examiner la demande d’autorisation d’exercice de la profession de médecin, de chirurgien-dentiste, de pharmacien ou de sage-femme en France même si le candidat n’a pas obtenu la reconnaissance de sa spécialité et/ou exercé 3 ans dans l’État membre qui a reconnu son titre étranger, s’accordent à juger, la Cour de justice de l’Union européenne et le Conseil d’État.
Dans un précédent article de septembre 2020, nous nous réjouissions de la position adoptée par les tribunaux administratifs sur le fondement du droit de l’Union européenne pour sanctionner le refus du CNG (Centre National de Gestion) de soumettre à la commission d’autorisation d’exercice, les demandes des candidats, titulaires d’un diplôme délivré par un État tiers et reconnu dans un État membre pour l’exercice de la profession, au motif que le candidat ne justifiait pas de la reconnaissance de son diplôme de spécialiste et/ou n’avait pas exercé 3 ans dans cet État membre d’origine ainsi que le prévoit expressément l’article L 4111-2 II du code de la santé publique, depuis l’ordonnance du 19 janvier 2017.
C’était sans compter, la cour administrative d’appel de Paris qui devait au contraire considérer que la jurisprudence Hocsman de la Cour de justice de l’Union européenne avait été intégrée dans la directive n° 2005/36/CE du 7 septembre 2005, transposée en droit interne, notamment à l’article L 4111-2 du code de la santé publique (voir notamment CAA de PARIS, 3ème chambre, 17 décembre 2021, 21PA01768 & 21PA03187; CAA de PARIS, 8ème chambre, 14 octobre 2021, 21PA00908 ; CAA Paris, 8e chambre, 26 septembre 2019, n° 18PA03174)
Deux courants jurisprudentiels s’opposaient alors sur le régime juridique applicable aux candidats à l’autorisation d’exercice des professions de médecin, de chirurgien-dentiste, de pharmacien ou de sage-femme, ressortissants de l’Union européenne, titulaires d’un diplôme délivré par un État tiers et reconnu par un État membre permettant d’y exercer la même profession.
Le premier, celui adopté initialement par le tribunal administratif de Paris en 2018, qui considérait à juste titre, que le candidat qui ne remplit pas les conditions énoncées par la Directive 2005/36/CE, relève directement du traité et des principes dégagés par la CJUE dans l’arrêt Hocsman du 14 septembre 2000 qui imposent à L’État membre d’accueil d’examiner le dossier du candidat :
« lorsque, dans une situation non régie par une directive relative à la reconnaissance mutuelle des diplômes, un ressortissant communautaire présente une demande d’autorisation d’exercer une profession dont l’accès est, selon la législation nationale, subordonnée à la possession d’un diplôme ou d’une qualification professionnelle, ou encore des périodes d’expérience pratique, les autorités compétentes de l’État membre concerné sont tenues de prendre en considération l’ensemble des diplômes, certificats et autres titres, ainsi que l’expérience pertinente de l’intéressé, en procédant à une comparaison entre, d’une part, les compétences attestées par ses titres et cette expérience, et, d’autre part les connaissances et qualifications exigées par la législation nationale ; que si cet examen comparatif des diplômes et de l’expérience professionnelle aboutit à la constatation que les connaissances et qualifications attestées par le diplôme obtenu à l’étranger correspondent à celles exigées par les dispositions nationales, les autorités compétentes de l’État membre d’accueil sont tenues d’admettre que ce diplôme et, éventuellement, l’expérience professionnelle remplissent les conditions posées par celles-ci ; que si, en revanche, la comparaison ne révèle qu’une correspondance partielle entre ces connaissances et qualifications, lesdites autorités sont en droit d’exiger que l’intéressé démontre qu’il a acquis les connaissances et qualifications non attestées ».
Les tribunaux administratifs de Lyon, de la Guyane, de Châlons-en-Champagne ou encore le rapporteur public Le Broussois que le tribunal administratif de Paris n’a pas suivi, ont adopté le même raisonnement juridique tendant à l’application, même en présence d’une directive de l’UE, des droits et libertés garantis par le traité comme la liberté de circulation et/ou d’établissement.
Le second courant, celui de la cour administrative d’appel de Paris, qui considère que l’article L 4111-2 II du code de la santé publique dans sa version issue de l’ordonnance du 19 janvier 2017, transpose la directive 2005/36/CE modifiée laquelle intègrerait la jurisprudence Hocsman, à ses articles 10 g et 3§3 de sorte que l’administration pouvait légalement rejeter les demandes d’autorisation d’exercice des candidats qui ne justifiaient pas d’un exercice le cas échéant dans la spécialité, d’une durée de 3 ans dans l’État membre qui a reconnu leur diplôme de base.
Le Conseil d’État, après la Cour de justice de l’Union européenne, a tranché en faveur des candidats à l’autorisation d’exercice dont le dossier doit être examiné par l’administration même s’ils ne remplissent pas les dispositions de la directive 2005/36/CE et par conséquent de l’article L4111-2 II du code de la santé publique.
Dans son arrêt du 8 juillet 2021, la Cour de justice de l’Union européenne, a confirmé les principes de la jurisprudence Hocsman rendue sous l’empire des anciennes directives sectorielles. Elle rappelle que dans une situation qui n’entre pas dans le champ d’application de la directive 2005/36/CE, l’État membre d’accueil concerné doit respecter ses obligations en matière de reconnaissance des qualifications professionnelles, lesquelles s’appliquent aux situations relevant tant de l’article 45 TFUE (liberté de circulation) que de l’article 49 TFUE (liberté d’établissement) et dit pour droit :
«Les articles 45 et 49 TFUE doivent être interprétés en ce sens que, dans une situation dans laquelle l’intéressé ne dispose pas du titre attestant sa qualification professionnelle de pharmacien, au sens de l’annexe V, point 5.6.2, de la directive 2005/36, telle que modifiée par la directive 2013/55, mais a acquis des compétences professionnelles relatives à cette profession tant dans l’État membre d’origine que dans l’État membre d’accueil, les autorités compétentes de ce dernier sont tenues, lorsqu’elles sont saisies d’une demande de reconnaissance des qualifications professionnelles, d’apprécier ces compétences et de les comparer avec celles requises dans l’État membre d’accueil aux fins d’accéder à la profession de pharmacien. Si ces compétences correspondent à celles exigées par les dispositions nationales de l’État membre d’accueil, celui-ci est tenu de les reconnaître. Si cet examen comparatif ne révèle qu’une correspondance partielle entre ces compétences, l’État membre d’accueil est en droit d’exiger que l’intéressé démontre qu’il a acquis les connaissances et les qualifications manquantes. Il incombe aux autorités nationales compétentes d’apprécier, le cas échéant, si les connaissances acquises dans l’État membre d’accueil, dans le cadre, notamment, d’une expérience pratique, peuvent valoir aux fins d’établir la possession des connaissances manquantes. Si ledit examen comparatif fait apparaître des différences substantielles entre la formation suivie par le demandeur et la formation requise dans l’État membre d’accueil, les autorités compétentes peuvent fixer des mesures de compensation pour combler ces différences. »
Le Conseil d’État ne pouvait plus tarder à admettre la supériorité du principe sur le droit interne. C’est chose faite avec l’arrêt n°436218 du 6 avril 2022, selon lequel :
« En vertu de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, notamment, en dernier lieu, de son arrêt C166/20 du 8 juillet 2021, il découle des articles 45 et 49 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, que, lorsque les autorités d'un Etat membre sont saisies par un ressortissant de l'Union d'une demande d'autorisation d'exercer une profession dont l'accès est, selon la législation nationale, subordonné à la possession d'un diplôme, d'une qualification professionnelle ou encore à des périodes d'expérience pratique, et que, faute pour le demandeur d'avoir obtenu un titre de formation le qualifiant, dans l’État membre d'origine, pour y exercer une profession réglementée, sa situation n'entre pas dans le champ d'application de la directive 2005/36 modifiée, elles sont tenues de prendre en considération l'ensemble des diplômes, certificats et autres titres, ainsi que l'expérience pertinente de l'intéressé, en rapport avec cette profession, acquis tant dans l’État membre d'origine que dans l’État membre d'accueil, en procédant à une comparaison entre d'une part les compétences attestées par ces titres et cette expérience et, d'autre part, les connaissances et qualifications exigées par la législation nationale. »
En conséquence, les candidats à l’autorisation d’exercice de la profession de médecin, chirurgien-dentiste, pharmacien ou sage-femme, ressortissants de l’Union européenne (et les bénéficiaires d’une égalité de traitement), titulaires d’un diplôme reconnu dans un État membre pour l’exercice de la profession, ont un droit à l’examen comparatif de leurs qualifications professionnelles (formation & expérience) acquises y compris dans l’État dans lequel ils demandent à exercer et par conséquent le cas échéant, en France même s’ils ne remplissent pas les conditions de l’article L 4111-2 II du code de la santé publique comme la reconnaissance du titre de spécialiste ou un exercice d’une durée de 3 ans dans l’État membre de reconnaissance.
Ces décisions de jurisprudence constituant un changement dans les circonstances de droit de la délivrance des autorisations d’exercice, les candidats dont le refus d’autorisation est devenu définitif, soit qu’il n’a pas été contesté devant le juge administratif, soit que le juge a estimé qu’il était légal, devraient pouvoir déposer une nouvelle demande sans qu’on puisse leur opposer le précédent refus.
Dans la même thématique
Replay Webinaire | 6 questions sur les lanceurs d’alerte
Nullité du contrat en l’absence d’informations sur le droit de rétractation
Le contrat de vente ou de prestations de services conclu dans un lieu qui n'est pas celui où le professionnel exerce habituellement son activité – dit contrat « hors établissement » – , doit comporter certaines informations, parmi lesquelles l’existence d’un droit de rétractation pour le souscripteur au contrat.
L’employeur peut-il demander l’annulation de la rupture conventionnelle si son salarié lui a menti sur ses motivations ?
De façon traditionnelle, lorsque l’on envisage la rupture du contrat de travail, il est invoqué la démission, à l’initiative du salarié, et le licenciement, à l’initiative de l’employeur. Toutefois, depuis la loi portant modernisation du marché du travail du 25 juin 2008, le législateur a instauré un mode de rupture amiable reposant sur l’accord du salarié et de l’employeur : la rupture conventionnelle.
Loyers commerciaux et Covid-19 : la Cour de cassation tranche en faveur des bailleurs
Par trois arrêts publiés et deux avis rendus le 30 juin dernier, la troisième chambre de la Cour de cassation statue enfin sur la question de l’exigibilité des loyers dus pendant la période de pandémie (Civ. 3e, 30 juin 2022, FS-B, n° 21-20.127 (1re espèce) et Avis ; Civ. 3e, 30 juin 2022, FS-B, n° 21-20.190 et Avis ; Civ. 3e, 30 juin 2022, FS-D, n° 21-19.889 (3e espèce) et Avis).
La mise à pied conservatoire : les risques d’un report de la procédure disciplinaire
La mise à pied conservatoire est une mesure de précaution autorisée par la loi, à l’article L 1332-3 du Code du Travail. Elle suppose que l’employeur ait eu connaissance de faits qu’il estime fautifs et suffisamment graves pour justifier la mise à l’écart du salarié de l’entreprise, dans l’attente de sa décision sur une sanction.
La Force Majeure à l’épreuve du COVID 19
Les regroupements doivent cesser, les mariages et les manifestations s’annulent en chaîne…les clients refusent de payer. La force majeure est agitée pour mettre fin à ses obligations contractuelles comme la chloroquine pour résister au virus c’est-à-dire dans la précipitation et sans étude des contrats, des lois en vigueur et des ordonnances à venir prises en vertu de la loi publiée le 24 mars 2020 sur l’état d’urgence sanitaire.