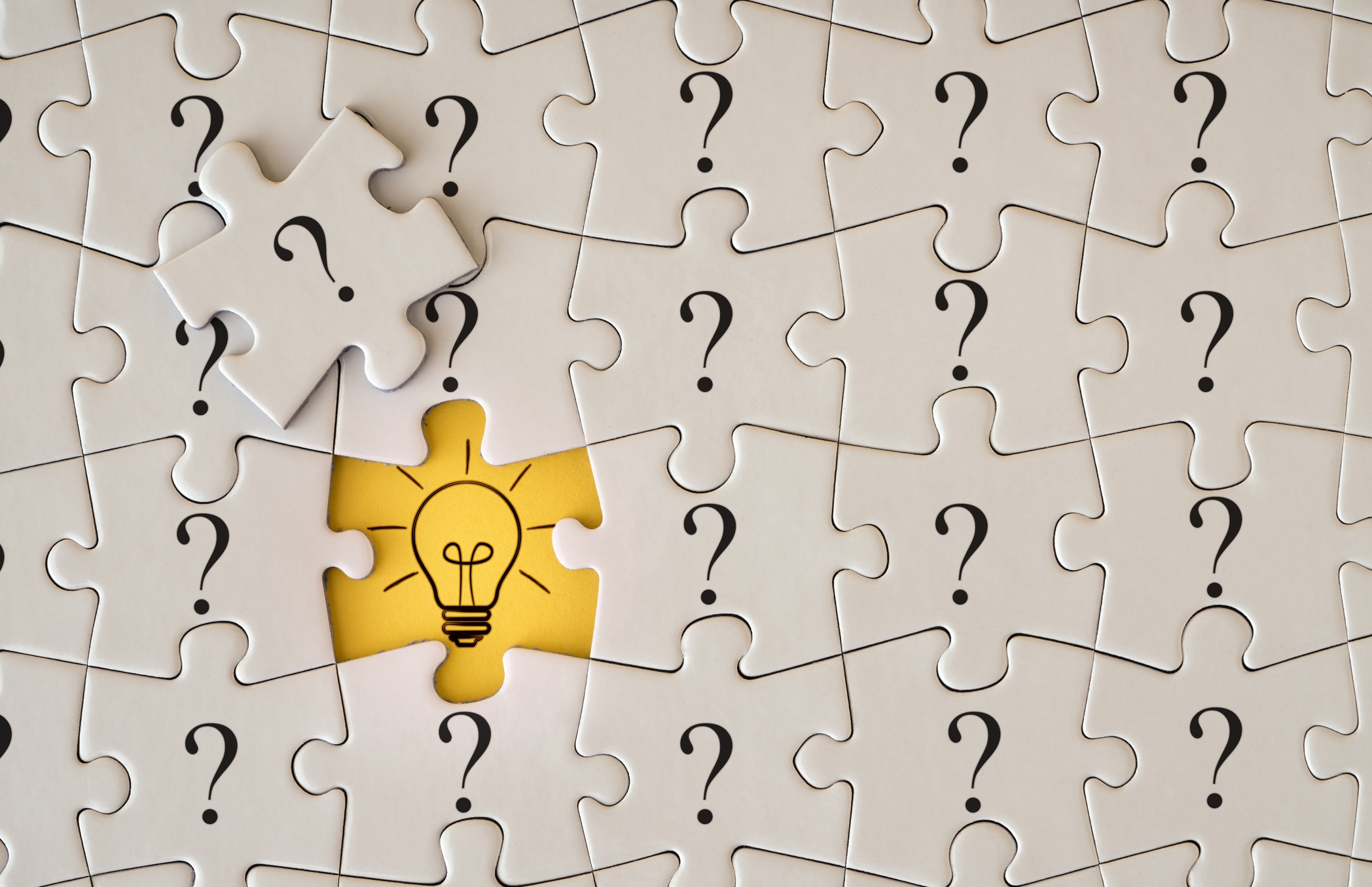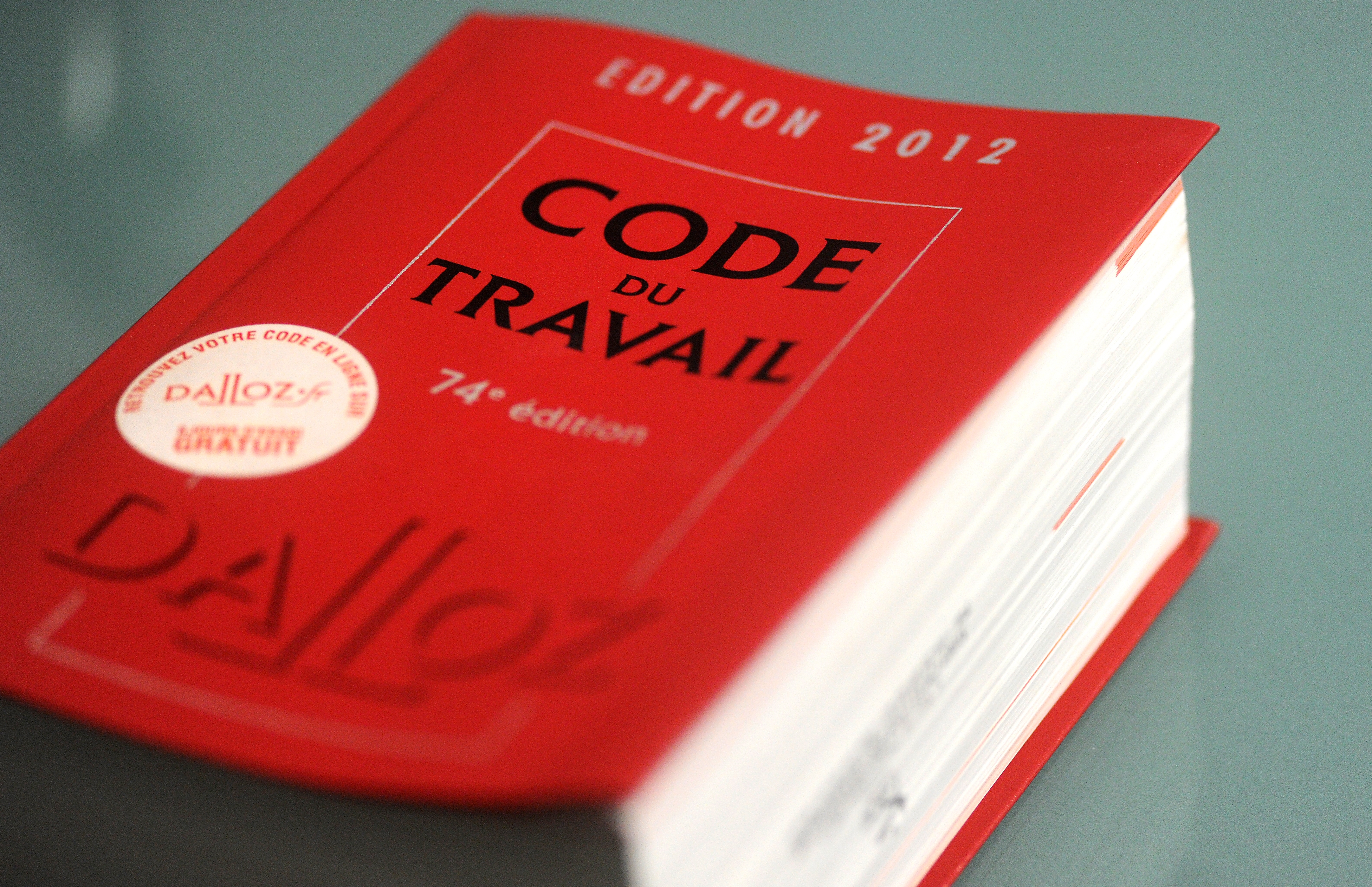Clause d’exclusivité : à utiliser avec une grande parcimonie
La clause d’exclusivité se retrouve dans de nombreux contrats de travail, comme allant de soi.
Une jurisprudence récente de la Cour de Cassation en date du 16 mai 2018 appelle au contraire à la plus grande prudence dans l’utilisation de cette clause.
En effet si la Cour de Cassation avait antérieurement rendu des décisions de principe en juillet 2000 concernant des salariés à temps partiel et plus précisément des VRP, elle avait déjà été amenée à préciser à l’époque que dans la mesure où une telle clause porte atteinte à la liberté du travail elle devait être, pour être valable, justifiée par la nature de la tâche à accomplir et proportionnée au but recherché.
Les décisions de 2000 n’étaient pas discutables dans la mesure où elles concernaient des salariés à temps partiel et la clause d’exclusivité incluse dans leur contrat les empêchait de fait d’exercer une activité complémentaire.
La récente décision de 2018 concerne elle un salarié à temps plein qui occupait les fonctions de chef de marché marketing et qui avait créé, en plus de son activité de salarié, une société de vente en ligne de vêtements et avait été licencié pour ce motif issu du non respect de la clause d’exclusivité par son employeur.
La Cour de Cassation confirme la décision rendue par la Cour d'Appel qui a jugé le licenciement non fondé, en indiquant que la clause était rédigée en termes généraux et imprécis, ne spécifiant pas les contours de l’activité complémentaire, et ne permettant pas de limiter son champ d’application ni de vérifier si elle était justifiée par la nature de la tâche à accomplir, proportionnée au but recherché et n’apportant pas de ce fait une restriction excessive à la liberté du travail.
La clause prévoyait pourtant la possibilité pour le salarié de demander l’autorisation préalable à son employeur afin d’engager une activité complémentaire.
Au vu de cette jurisprudence, il apparait donc nécessaire si l’employeur souhaite impérativement inclure une clause d’exclusivité, que celle-ci soit précise sur ses limites, activité bénévole ou lucrative, professionnelle ou de loisir. Plus les restrictions à la liberté du travail seront à la fois détaillées et limitées, et plus elles seront motivées, plus la clause trouvera alors sa pertinence et sa capacité d’application.
Le simple fait de l’inscrire en termes généraux n’est donc plus cohérent, même si le salarié est engagé dans le cadre d’un temps complet.
« Mais attendu qu'ayant constaté que la clause d'exclusivité était rédigée en termes généraux et imprécis ne spécifiant pas les contours de l'activité complémentaire qui serait envisagée par le salarié, activité bénévole ou lucrative, professionnelle ou de loisirs et qu'ils ne permettaient pas dès lors de limiter son champ d'application ni de vérifier si la restriction à la liberté du travail était justifiée et proportionnée, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche inopérante au vu de ces constatations, a légalement justifié sa décision ».(Cassation sociale du 16.05.2018, n°16-25.272)
Gérard THIEBAUT
Avocat en Droit du Travail dans la Marne (51)
Dans la même thématique
Calcul du délai de convocation à l’entretien préalable au licenciement : rappel des règles applicables
Dans l’arrêt rendu le 12 mars 2025, la chambre sociale de la Cour de cassation a réaffirmé avec force le caractère impératif du délai de 5 jours pleins entre la convocation à l’entretien préalable au licenciement et la tenue de l’entretien afin de permettre au salarié de bénéficier d’un temps suffisant pour préparer sa défense. Elle a rappelé très précisément les règles du calcul du délai de convocation et l’incidence des jours fériés.
Arrêt-maladie pendant ses vacances : un report des jours de congés désormais possible
Dans un arrêt rendu le 10 septembre 2025, la Cour de cassation a opéré un tournant majeur dans sa jurisprudence en considérant qu’un salarié a droit au report de ses jours de congés payés dès lors qu’il n’a pas pu les exercer utilement pour cause d’arrêt de travail survenu pendant la période.
La garantie de l’AGS étendue à la prise d’acte et à la résiliation judiciaire
Dans deux arrêts rendus le 8 janvier 2025, la Cour de cassation a opéré un important revirement de jurisprudence, en élargissant le champ d’application de l’assurance garantie des salaires (AGS).
La garantie des salaires, prévue par la loi, vise à protéger le salarié en prévoyant, sous certaines conditions, le paiement des créances résultant de son contrat de travail lorsque l’employeur est soumis à une procédure collective (sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire).
Quel droit pour le salarié en l’absence d’organisation de la visite médicale de reprise ?
Il apparait utile de rappeler que l’employeur a l’obligation d’organiser une visite médicale de reprise, dans un délai de 8 jours, dès qu’il a connaissance de la fin de l’arrêt de travail du salarié (article R4624-31 du code du travail, en vigueur depuis le 28 avril 2022) :
- en cas d’absence d’au moins 30 jours à la suite d’un accident du travail,
Incidence du refus du salarié de se voir remettre la note l’informant du motif économique de la rupture avant acceptation du contrat de sécurisation professionnelle
Dans l’arrêt rendu le 6 mai 2025, la chambre sociale de la Cour de cassation est venue préciser encore davantage le principe selon lequel il appartient à l’employeur d’informer le salarié par écrit, et au plus tard au moment de l’acceptation du contrat de sécurisation professionnelle (CSP), du motif économique justifiant la rupture du contrat.
Activités sociales et culturelles des CSE et critères d’ancienneté : les nouvelles règles applicables
L’article L 2312-78 du Code du Travail précise, à propos des attributions du Comité Social et Economique dans les entreprises d’au moins 50 salariés, que :
« Le Comité Social et Economique assure, contrôle ou participe à la gestion de toutes les activités sociales et culturelles établies dans l'entreprise prioritairement au bénéfice des salariés, de leur famille et des stagiaires, quel qu'en soit le mode de financement, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat (…) ».
Une pratique courante existait dans de nombreux CSE : le critère d’ancienneté de 6 mois.
Les indemnités en cas de licenciement pour inaptitude
Le Code du Travail réserve un sort différent pour le salarié licencié dans le cadre d’une inaptitude d’origine professionnelle, par rapport au salarié licencié dans le cadre d’une inaptitude non professionnelle.
Cependant, l’appréciation du caractère professionnel d’une inaptitude n’est pas strictement liée à la reconnaissance préalable par l’organisme de Sécurité Sociale d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle.
Le principe souvent oublié est celui de l’indépendance des législations entre le Code du Travail et le Code de la Sécurité Sociale.
Le licenciement pour faute grave est valable même en l’absence de mise à pied à titre conservatoire
Un salarié peut être licencié pour faute grave lorsqu’il a commis des faits qui rendent impossible son maintien dans l’entreprise. Tel est le cas par exemple de violences commises à l’encontre d’un supérieur ou d’un collègue, d’un vol de matériel, du non-respect des règles de sécurité, …
Dans cette hypothèse, l’employeur prend fréquemment une mesure de mise à l’écart du salarié de l’entreprise, sous la forme d’une mise à pied conservatoire : le salarié est invité à quitter immédiatement son poste.