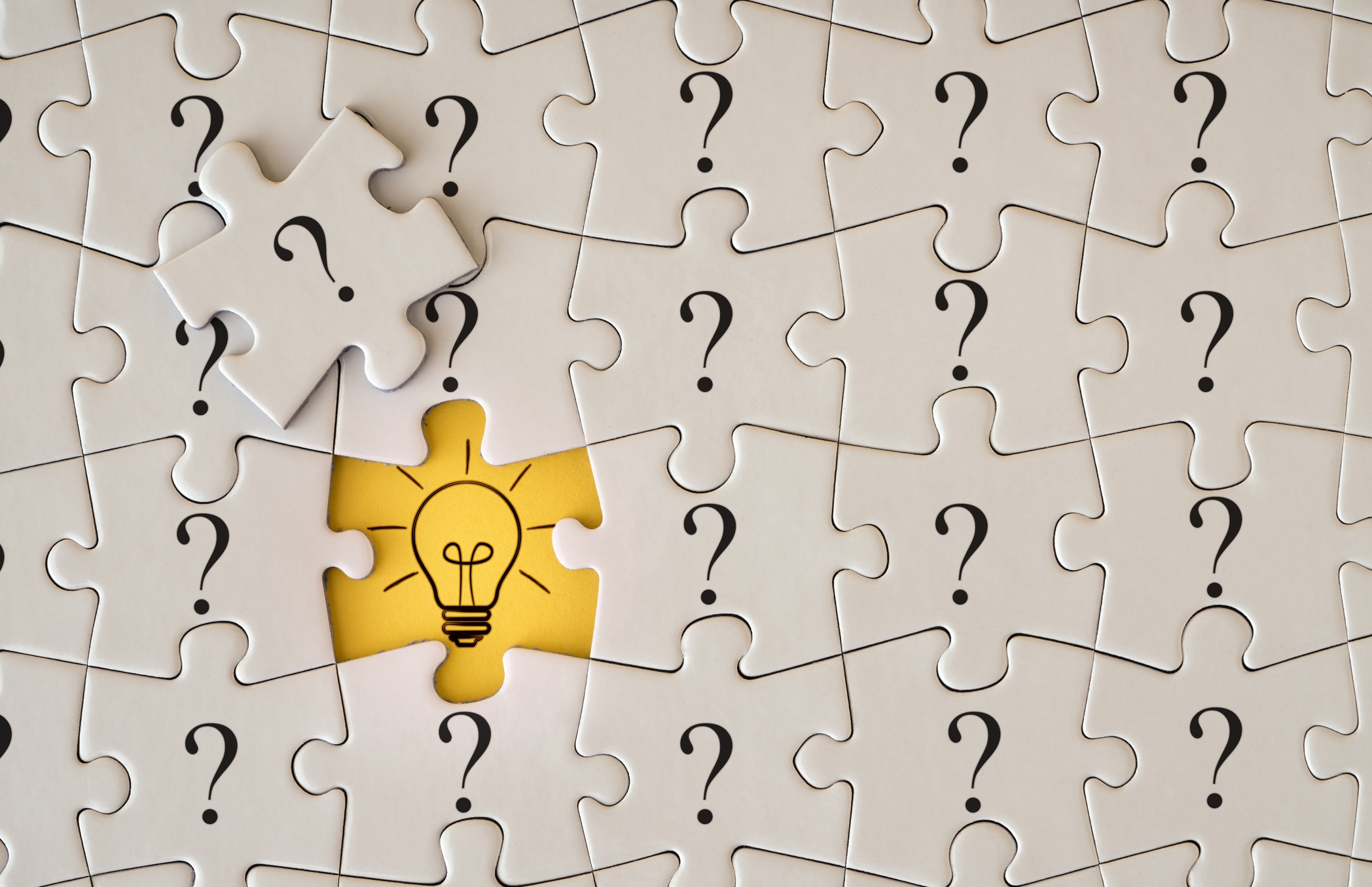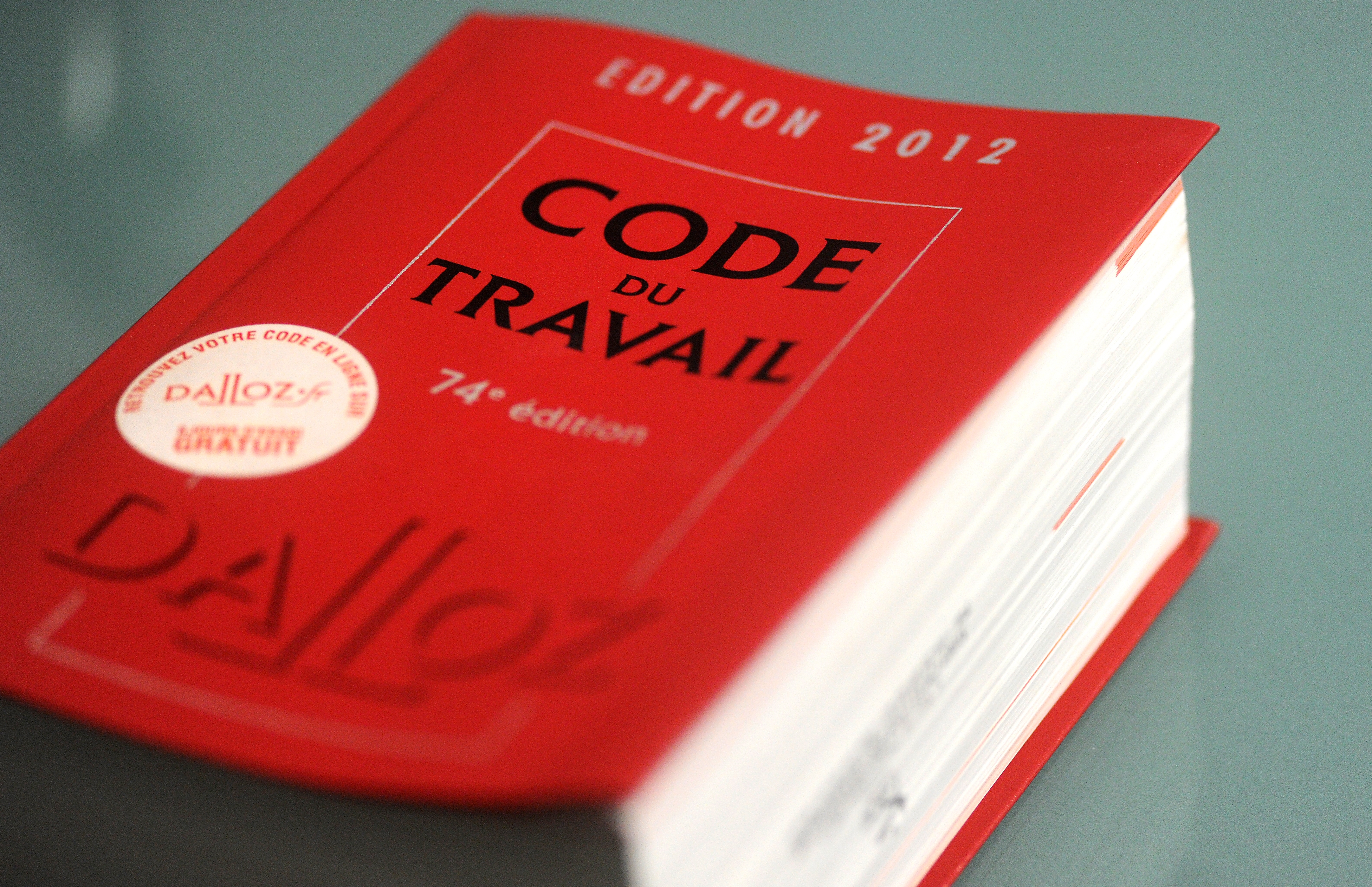L’application de la législations sur les risques professionnels en cas de changement légal d’employeur

L’article L 1224-1 du Code du Travail dispose :
« Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l’entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le Personnel de l’entreprise. » La question qui se pose est celle de l’impact de ce changement légal d’employeur vis-à-vis des droits attachés à la reconnaissance d’un accident du travail, d’une maladie professionnelle ou d’une rechute liée à ces accidents CHEZ LE PREMIER EMPLOYEUR.
L’action en reconnaissance de faute inexcusable du salarié n’est ouverte que contre un accident du travail ou une maladie professionnelle.
Toute action de reconnaissance de faute inexcusable vis-à-vis d’une rechute n’est pas permise par la loi.
Dans l’hypothèse d’un changement légal d’employeur, l’action en reconnaissance de faute inexcusable fait, elle, partie des droits à transférer avec le contrat de travail et quel employeur doit être actionné en ce sens.
La Cour de cassation, aux termes d’un arrêt du 17 septembre 2015, a admis que le nouvel employeur pouvait être attrait devant les juridictions de Sécurité Sociale pour faire reconnaître la faute inexcusable liée à son accident du travail ou sa maladie professionnelle (N°14-24.534).
Il faut néanmoins réserver les cas particuliers, visés à l’article L 1224-2 du même Code du Travail qui prévoit l’absence de transfert des obligations qui incombaient à l’ancien employeur, dans l’hypothèse d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, ou encore lorsqu’il y a substitution d’employeur, sans qu’il y ait de convention entre ceux-ci.
Dans ce cas de figure, ce sont bien les organes de la procédure collective qu’il faut attraire devant la juridiction de Sécurité Sociale pour faire reconnaître la faute inexcusable.
La Caisse fait alors l‘avance des condamnations à la victime ou ses ayant-droits, charge à cette dernière de faire valoir ses droits dans la procédure collective.
Dans l’hypothèse d’une substitution d’employeur intervenue sans qu’il y ait de convention entre ceux-ci, c’est encore l’employeur initial qui doit être actionné en reconnaissance de faute inexcusable.
Dans tous les autres cas de figure, le nouvel employeur est bien tenu de répondre de toute action en reconnaissance de faute inexcusable.
Le premier employeur reste néanmoins tenu au remboursement des sommes acquittées par le second.
D’un point de vue procédural, cette action en remboursement peut être effectuée dans le cadre de l’instance initiale en reconnaissance de faute inexcusable.
Il s’agit, en effet, d’une demande accessoire à la demande principale.
Le nouvel employeur, de par l’application de l’article L 1224-1 précité, est encore tenu d’appliquer l’ensemble des dispositions protectrices du Code du Travail pour les salariés victimes d’accident du travail ou de maladie professionnelle.
Toutes les dispositions conventionnelles du type garantie de maintien de salaire, ou même garantie de maintien de l’emploi, dans les hypothèses d’accident du travail ou de maladie professionnelle, s’imposent également au nouvel employeur.
L’ensemble de ces principes s’appliquent également dans l’hypothèse d’une application volontaire de l’article L 1224-1 (Cass. Soc. 9 juillet 1992, n°91-40.015).
L’application des dispositions conventionnelles visant à la reprise du Personnel, dans l’hypothèse d’une perte de marché, peut ne correspondre cependant ni à l’application légale ou volontaire de l’article L 1224-1.
Dans ces conditions, l’employeur n’est tenu à aucune obligation (Cass. Ch. Soc. 14 mars 2007, n°05-43.184).
C’est notamment le cas des clauses de reprise de personnel, prévues à la Convention Collective des Entreprises de Propreté figurant dans ce qui est communément appelé « l’annexe 7 ».
Le nouvel employeur, dans l’hypothèse d’un transfert légal, sera également tenu à l’ensemble des obligations liées à la législation sur le risque professionnel et des dispositions protectrices du salarié victime d’un accident du travail, dans l’hypothèse d’une rechute à son service de ce salarié ; et ce, même si l’accident du travail est survenu au service du précédent employeur (Cass. Soc. 1er décembre 1993, n°91-43.478).
Enfin, il convient de rappeler que la protection est admise en cas de rechute au service du second employeur, même lorsque l’article L 1224-1 du Code du Travail ne s’applique pas, dès lors qu’il existe un lien de causalité entre la rechute et les nouvelles conditions de travail (Cass. Soc. 28 mars 2007, n°06-41.375).
Dans la même thématique
Quel droit pour le salarié en l’absence d’organisation de la visite médicale de reprise ?
Il apparait utile de rappeler que l’employeur a l’obligation d’organiser une visite médicale de reprise, dans un délai de 8 jours, dès qu’il a connaissance de la fin de l’arrêt de travail du salarié (article R4624-31 du code du travail, en vigueur depuis le 28 avril 2022) :
- en cas d’absence d’au moins 30 jours à la suite d’un accident du travail,
Incidence du refus du salarié de se voir remettre la note l’informant du motif économique de la rupture avant acceptation du contrat de sécurisation professionnelle
Dans l’arrêt rendu le 6 mai 2025, la chambre sociale de la Cour de cassation est venue préciser encore davantage le principe selon lequel il appartient à l’employeur d’informer le salarié par écrit, et au plus tard au moment de l’acceptation du contrat de sécurisation professionnelle (CSP), du motif économique justifiant la rupture du contrat.
Inaptitude : la situation du salarié pendant la période de reclassement
Le Code du Travail autorise l’employeur à licencier son salarié après un avis médical d’Inaptitude prononcé par le médecin du travail.
Si le Code du Travail prévoit une période d’un mois à compter de l’avis d’Inaptitude, au terme duquel l’employeur doit soit licencier, soit reclasser le salarié, il ne s’agit pas d’une règle impérative. Pendant toute cette période, l’employeur doit rechercher un reclassement du salarié conforme aux préconisations du médecin du travail.
Ces recherches peuvent aller au-delà d’un mois.
Le licenciement pour faute grave est valable même en l’absence de mise à pied à titre conservatoire
Un salarié peut être licencié pour faute grave lorsqu’il a commis des faits qui rendent impossible son maintien dans l’entreprise. Tel est le cas par exemple de violences commises à l’encontre d’un supérieur ou d’un collègue, d’un vol de matériel, du non-respect des règles de sécurité, …
Dans cette hypothèse, l’employeur prend fréquemment une mesure de mise à l’écart du salarié de l’entreprise, sous la forme d’une mise à pied conservatoire : le salarié est invité à quitter immédiatement son poste.