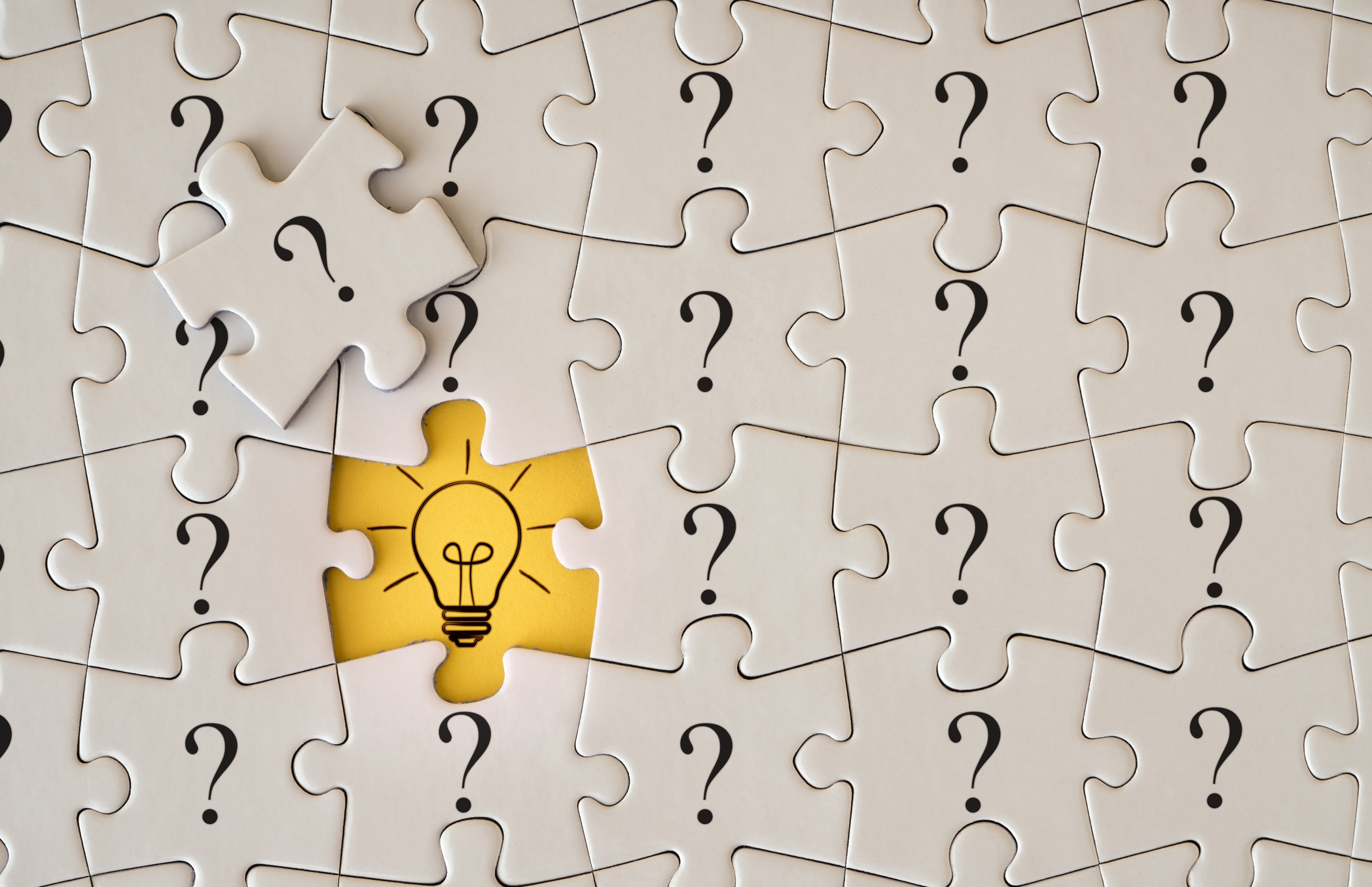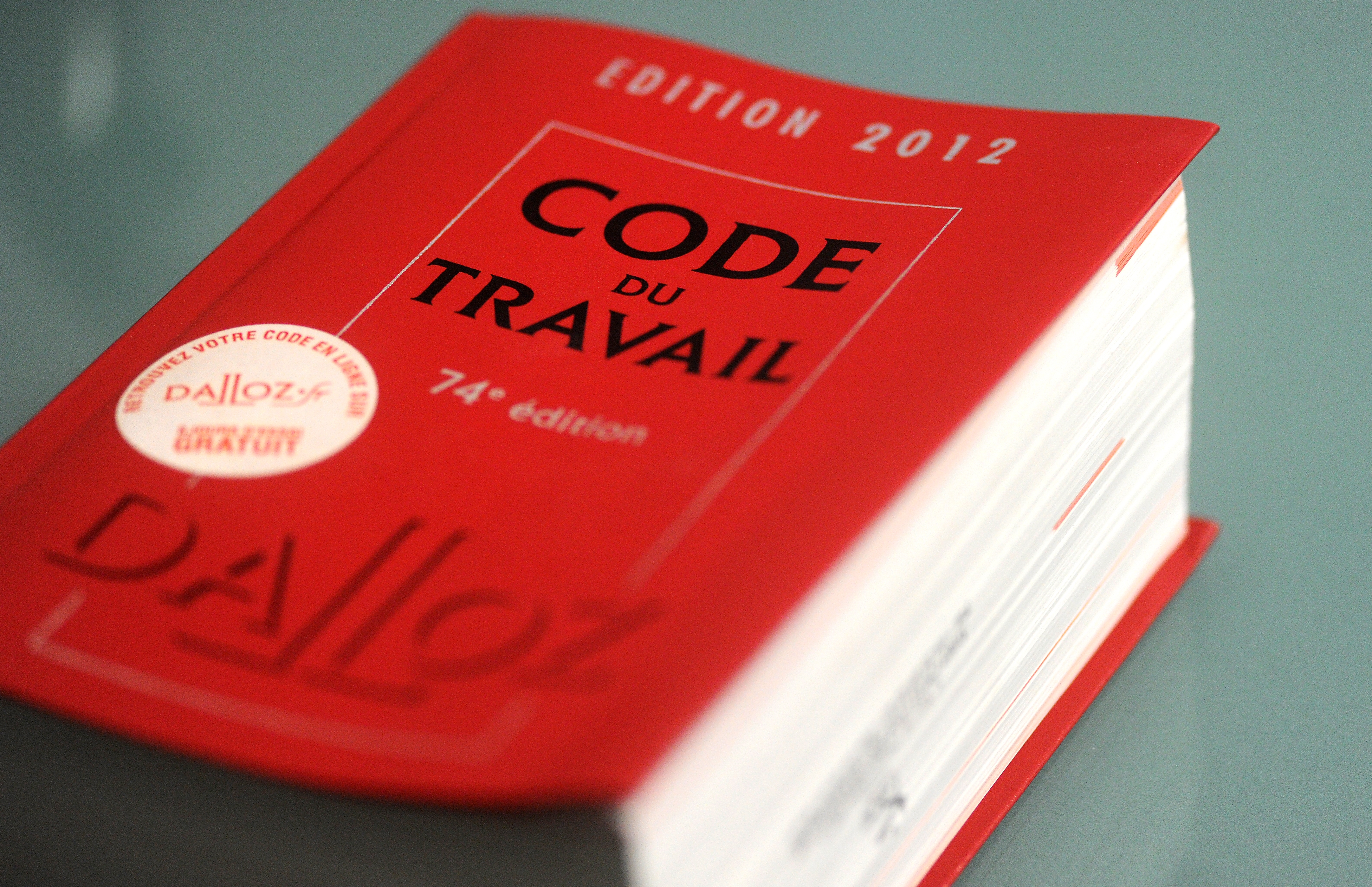Réforme du travail à temps partiel : Travailler plus pour gagner plus ?
Durée hebdomadaire de travail minimale de 24h, majoration de 10% dès la première heure complémentaire au delà de l'horaire contractuel, instauration d'un complément d'heures par accord de branche étendu : Me Vanessa Lehmann fait le point sur la nouvelle réglementation dans les actualités juridiques de Matot Braine N°7550.
L’Accord National Interprofessionnel (ANI) du 11 janvier 2013, relayé par la Loi du 14 juin 2013 relative à la Sécurisation de l’Emploi, l’avaient prévu : le travail à temps partiel « subi » doit être revu en profondeur. Le principe nouveau instaure une durée minimale d’emploi en France fixée à 24 heures hebdomadaires (ou l’équivalent mensuel ou annuel, selon la formule retenue). Le principe est simple … mais sa mise en œuvre tellement complexe qu’outre les nombreuses exceptions, l’application dans le temps s’avère fastidieuse.
C’est ainsi que six mois après l’ANI, la Loi avait décalé de nouveau de six mois l’entrée en vigueur de la réforme, tout en aménageant une période transitoire de deux ans, jusqu’au 1er janvier 2016. Et puis le 10 janvier dernier, les organisations syndicales et patronales signataires de l’ANI avaient obtenu du Ministère du Travail un report au 1er juillet 2014 la date d’entrée en vigueur de l’augmentation de la durée du travail à temps partiel.
L’objectif était de permettre aux partenaires sociaux dans les branches de poursuivre leurs négociations sur la mise en œuvre de ce nouveau principe, et surtout de ses exceptions. Il est vrai qu’à cette date, près de la moitié des branches principalement concernées par l’obligation de négocier dans ce domaine n’étaient pas encore parvenues à un accord. C’est dans ces conditions que la Loi 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la Formation Professionnelle, à l’Emploi et à la Démocratie Sociale a acté ce nouveau report de six mois. Cette suspension jusqu’au 30 juin 2014 n’a cependant pris effet qu’à compter du 22 janvier dernier.
Une durée minimale légale de 24 heures par semaine
-> Lire la suite de l'article
Dans la même thématique
Quel droit pour le salarié en l’absence d’organisation de la visite médicale de reprise ?
Il apparait utile de rappeler que l’employeur a l’obligation d’organiser une visite médicale de reprise, dans un délai de 8 jours, dès qu’il a connaissance de la fin de l’arrêt de travail du salarié (article R4624-31 du code du travail, en vigueur depuis le 28 avril 2022) :
- en cas d’absence d’au moins 30 jours à la suite d’un accident du travail,
Incidence du refus du salarié de se voir remettre la note l’informant du motif économique de la rupture avant acceptation du contrat de sécurisation professionnelle
Dans l’arrêt rendu le 6 mai 2025, la chambre sociale de la Cour de cassation est venue préciser encore davantage le principe selon lequel il appartient à l’employeur d’informer le salarié par écrit, et au plus tard au moment de l’acceptation du contrat de sécurisation professionnelle (CSP), du motif économique justifiant la rupture du contrat.
Inaptitude : la situation du salarié pendant la période de reclassement
Le Code du Travail autorise l’employeur à licencier son salarié après un avis médical d’Inaptitude prononcé par le médecin du travail.
Si le Code du Travail prévoit une période d’un mois à compter de l’avis d’Inaptitude, au terme duquel l’employeur doit soit licencier, soit reclasser le salarié, il ne s’agit pas d’une règle impérative. Pendant toute cette période, l’employeur doit rechercher un reclassement du salarié conforme aux préconisations du médecin du travail.
Ces recherches peuvent aller au-delà d’un mois.
Le licenciement pour faute grave est valable même en l’absence de mise à pied à titre conservatoire
Un salarié peut être licencié pour faute grave lorsqu’il a commis des faits qui rendent impossible son maintien dans l’entreprise. Tel est le cas par exemple de violences commises à l’encontre d’un supérieur ou d’un collègue, d’un vol de matériel, du non-respect des règles de sécurité, …
Dans cette hypothèse, l’employeur prend fréquemment une mesure de mise à l’écart du salarié de l’entreprise, sous la forme d’une mise à pied conservatoire : le salarié est invité à quitter immédiatement son poste.