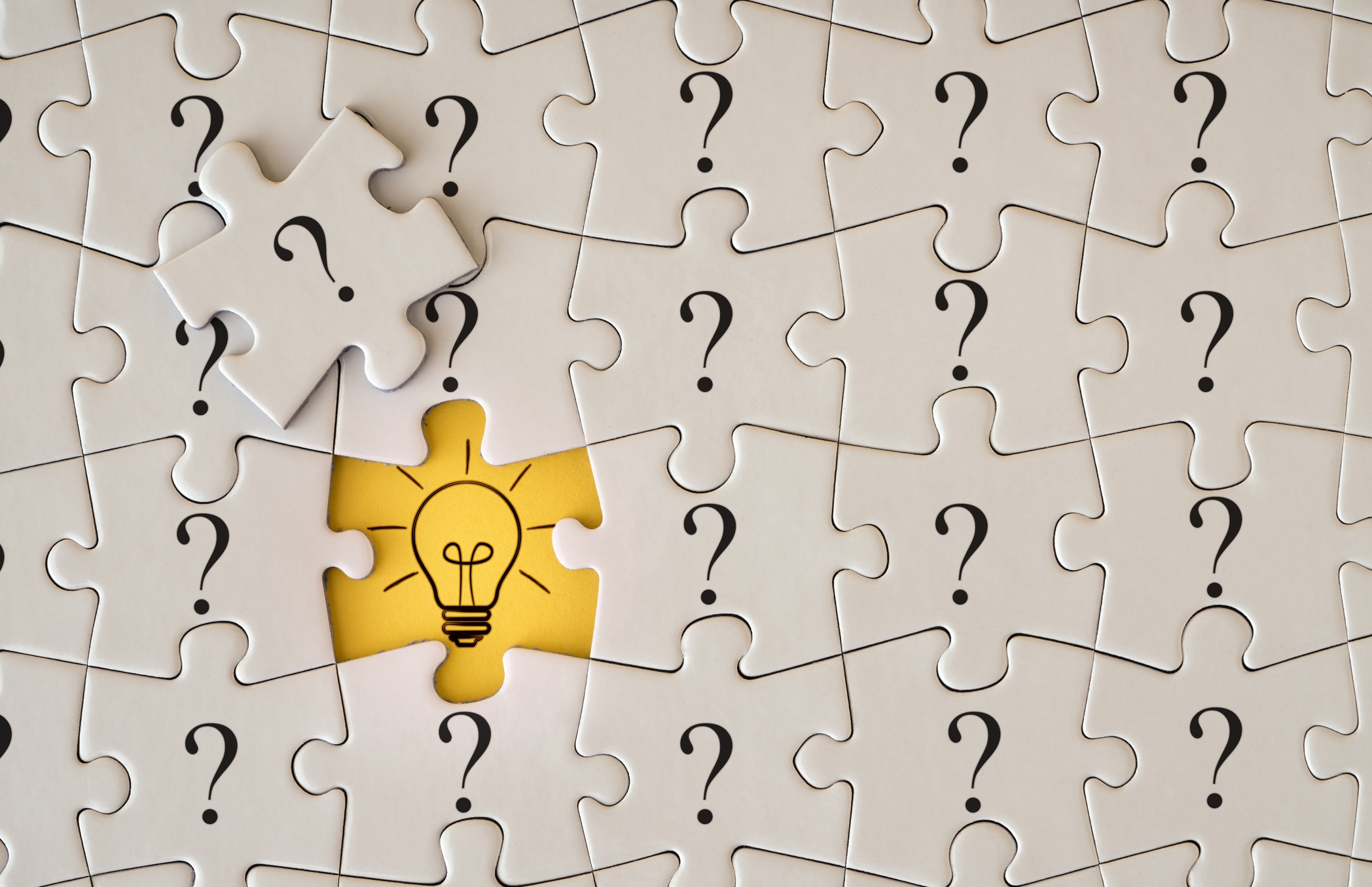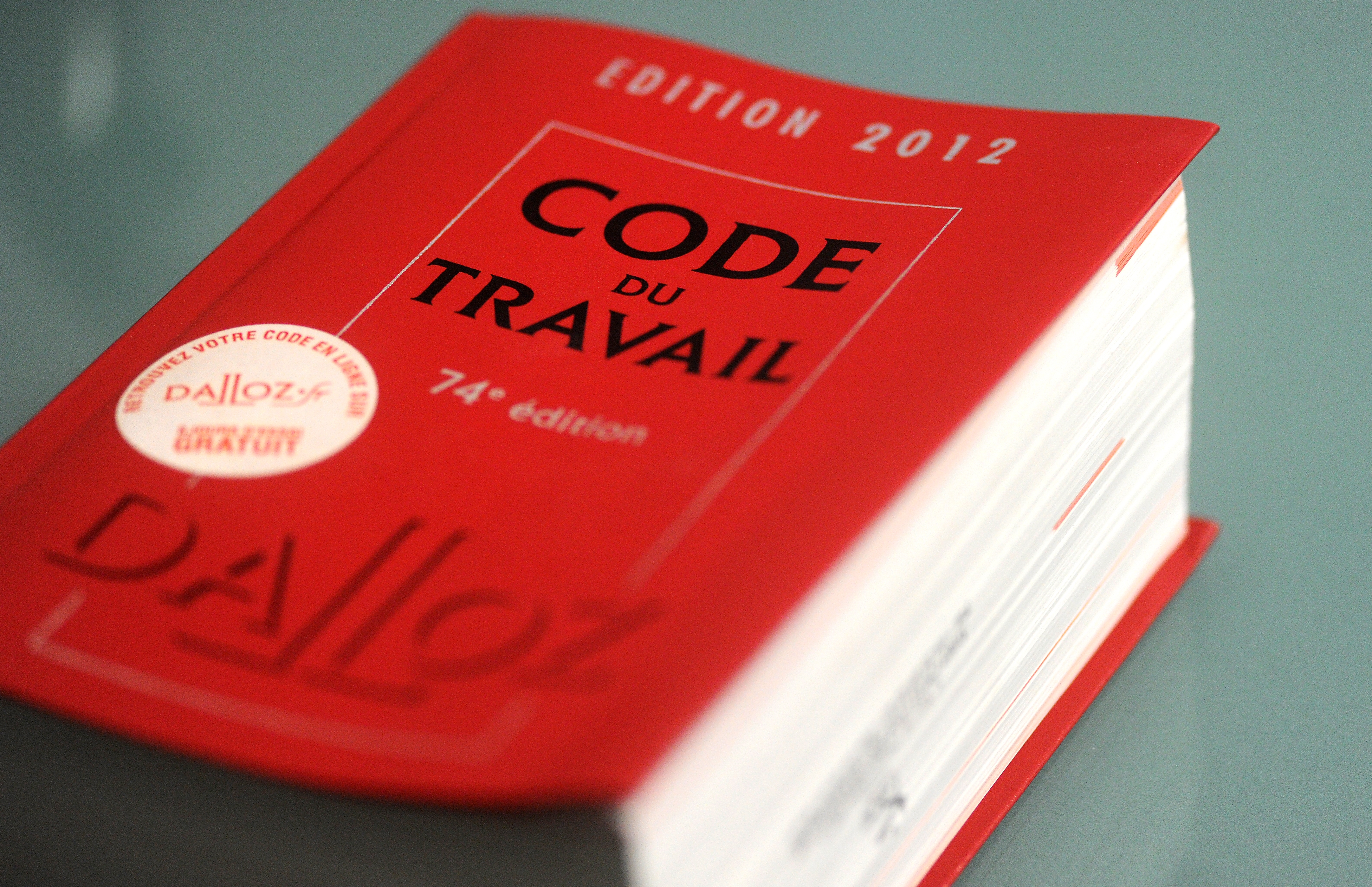ACCIDENT DU TRAVAIL ET MALADIE PROFESSIONNELLE : le cas particulier de la rechute chez un nouvel employeur

Suite à un accident du travail ou une maladie professionnelle, la reprise du travail se fait par la délivrance d’un certificat médical final de guérison ou de consolidation par le médecin. Ce certificat indique que les lésions et séquelles dues à l’accident du travail ou la maladie professionnelle sont guéries ou fixées. Il arrive cependant, qu’après guérison ou consolidation, l’état de santé du salarié s’aggrave : on parte de rechute de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle initiale.
Cette rechute peut se produire chez un nouvel employeur, bien distinct de celui chez lequel le bénéfice de la législation pour risques professionnels a été reconnu au salarié pour l’accident ou la maladie professionnelle initiale. En principe, cette rechute doit être considérée par le nouvel employeur comme un arrêt-maladie ordinaire, elle ne lui est pas opposable.
La procédure de reconnaissance de la rechute est mise en œuvre à l’encontre de l’employeur initial, chez lequel s’est produit l’évènement traumatique. Le nouvel employeur est néanmoins lié par certaines obligations. Il est donc tenu à la garantie de maintien de salaire à hauteur de 90 % du salaire brut pendant le premier mois d’arrêt. Il doit assurer la rédaction de l’attestation de salaire et la transmettre au salarié et à la Caisse.
Le salarié perçoit de la Caisse des indemnités journalières de Sécurité Sociale, calculées sur la base du salaire mensuel précédant la rechute.
Il convient donc bien de prendre en compte ici le salaire mensuel chez le nouvel employeur, pour la rédaction de l’attestation de salaire.
En tout état de cause, le montant de cette indemnité journalière ne peut être inférieure au montant de l’indemnité journalière que le salarié percevait dans le cadre de son accident ou maladie professionnelle initiale.
Il convient de déduire ici, le cas échéant, les éléments de la rente que perçoit le salarié dans l’hypothèse d’une consolidation avec séquelles indemnisables.
La rechute peut devenir un élément déterminant en ce qui concerne les droits du salarié. La rechute d’un accident subi antérieurement est en effet, en principe, traité comme une affection non professionnelle par le nouvel employeur. Le Code du Travail organise ainsi un régime différent de licenciement dans le cadre d’une inaptitude d’origine professionnelle ou non professionnelle.
Cependant, la Cour de cassation a nuancé le principe.
Comme pour les accidents du travail ou les maladies professionnelles initiales, il suffit qu’un évènement lié au nouvel emploi ait pu contribuer partiellement à la rechute pour que le salarié puisse bénéficier, chez son nouvel employeur, des dispositions spécifiques du Code du Travail relative à l’inaptitude professionnelle.
Ainsi, si le salarié établit un lien de causalité, même partiel, entre la rechute et son travail chez le nouvel employeur, celui-ci bénéficie de l’ensemble des dispositions protectrices du Code du Travail, liés aux risques professionnels.
Un tel salarié ne peut donc être licencié que pour faute grave ou doit encore bénéficier des garanties de procédure et d’indemnisation propres à un licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle.
Il doit également bénéficier de l’ensemble des dispositions spécifiques des Conventions Collectives qui organisent, pour certaines, des garanties de maintien dans l’emploi dans l’hypothèse d’un arrêt de travail lié à une pathologie d’origine professionnelle
La responsabilité du nouvel employeur pourra être recherchée, au titre du manquement à l’obligation de prévention des risques professionnels et l’obligation de sécurité de résultat, si les nouvelles conditions de travail ont contribué à la rechute.
En effet, si l’action en reconnaissance de faute inexcusable n’est pas ouverte contre le nouvel employeur dans l’hypothèse d’une rechute, sa responsabilité sur le terrain de l’obligation de sécurité de résultat peut être recherchée devant le Conseil de Prud’hommes.
Pour tous ces droits et démarches, l’assistance d’un Avocat est vivement conseillé.
Dans la même thématique
Calcul du délai de convocation à l’entretien préalable au licenciement : rappel des règles applicables
Dans l’arrêt rendu le 12 mars 2025, la chambre sociale de la Cour de cassation a réaffirmé avec force le caractère impératif du délai de 5 jours pleins entre la convocation à l’entretien préalable au licenciement et la tenue de l’entretien afin de permettre au salarié de bénéficier d’un temps suffisant pour préparer sa défense. Elle a rappelé très précisément les règles du calcul du délai de convocation et l’incidence des jours fériés.
Arrêt-maladie pendant ses vacances : un report des jours de congés désormais possible
Dans un arrêt rendu le 10 septembre 2025, la Cour de cassation a opéré un tournant majeur dans sa jurisprudence en considérant qu’un salarié a droit au report de ses jours de congés payés dès lors qu’il n’a pas pu les exercer utilement pour cause d’arrêt de travail survenu pendant la période.
La garantie de l’AGS étendue à la prise d’acte et à la résiliation judiciaire
Dans deux arrêts rendus le 8 janvier 2025, la Cour de cassation a opéré un important revirement de jurisprudence, en élargissant le champ d’application de l’assurance garantie des salaires (AGS).
La garantie des salaires, prévue par la loi, vise à protéger le salarié en prévoyant, sous certaines conditions, le paiement des créances résultant de son contrat de travail lorsque l’employeur est soumis à une procédure collective (sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire).
Quel droit pour le salarié en l’absence d’organisation de la visite médicale de reprise ?
Il apparait utile de rappeler que l’employeur a l’obligation d’organiser une visite médicale de reprise, dans un délai de 8 jours, dès qu’il a connaissance de la fin de l’arrêt de travail du salarié (article R4624-31 du code du travail, en vigueur depuis le 28 avril 2022) :
- en cas d’absence d’au moins 30 jours à la suite d’un accident du travail,
Incidence du refus du salarié de se voir remettre la note l’informant du motif économique de la rupture avant acceptation du contrat de sécurisation professionnelle
Dans l’arrêt rendu le 6 mai 2025, la chambre sociale de la Cour de cassation est venue préciser encore davantage le principe selon lequel il appartient à l’employeur d’informer le salarié par écrit, et au plus tard au moment de l’acceptation du contrat de sécurisation professionnelle (CSP), du motif économique justifiant la rupture du contrat.
Activités sociales et culturelles des CSE et critères d’ancienneté : les nouvelles règles applicables
L’article L 2312-78 du Code du Travail précise, à propos des attributions du Comité Social et Economique dans les entreprises d’au moins 50 salariés, que :
« Le Comité Social et Economique assure, contrôle ou participe à la gestion de toutes les activités sociales et culturelles établies dans l'entreprise prioritairement au bénéfice des salariés, de leur famille et des stagiaires, quel qu'en soit le mode de financement, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat (…) ».
Une pratique courante existait dans de nombreux CSE : le critère d’ancienneté de 6 mois.
Les indemnités en cas de licenciement pour inaptitude
Le Code du Travail réserve un sort différent pour le salarié licencié dans le cadre d’une inaptitude d’origine professionnelle, par rapport au salarié licencié dans le cadre d’une inaptitude non professionnelle.
Cependant, l’appréciation du caractère professionnel d’une inaptitude n’est pas strictement liée à la reconnaissance préalable par l’organisme de Sécurité Sociale d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle.
Le principe souvent oublié est celui de l’indépendance des législations entre le Code du Travail et le Code de la Sécurité Sociale.
Le licenciement pour faute grave est valable même en l’absence de mise à pied à titre conservatoire
Un salarié peut être licencié pour faute grave lorsqu’il a commis des faits qui rendent impossible son maintien dans l’entreprise. Tel est le cas par exemple de violences commises à l’encontre d’un supérieur ou d’un collègue, d’un vol de matériel, du non-respect des règles de sécurité, …
Dans cette hypothèse, l’employeur prend fréquemment une mesure de mise à l’écart du salarié de l’entreprise, sous la forme d’une mise à pied conservatoire : le salarié est invité à quitter immédiatement son poste.