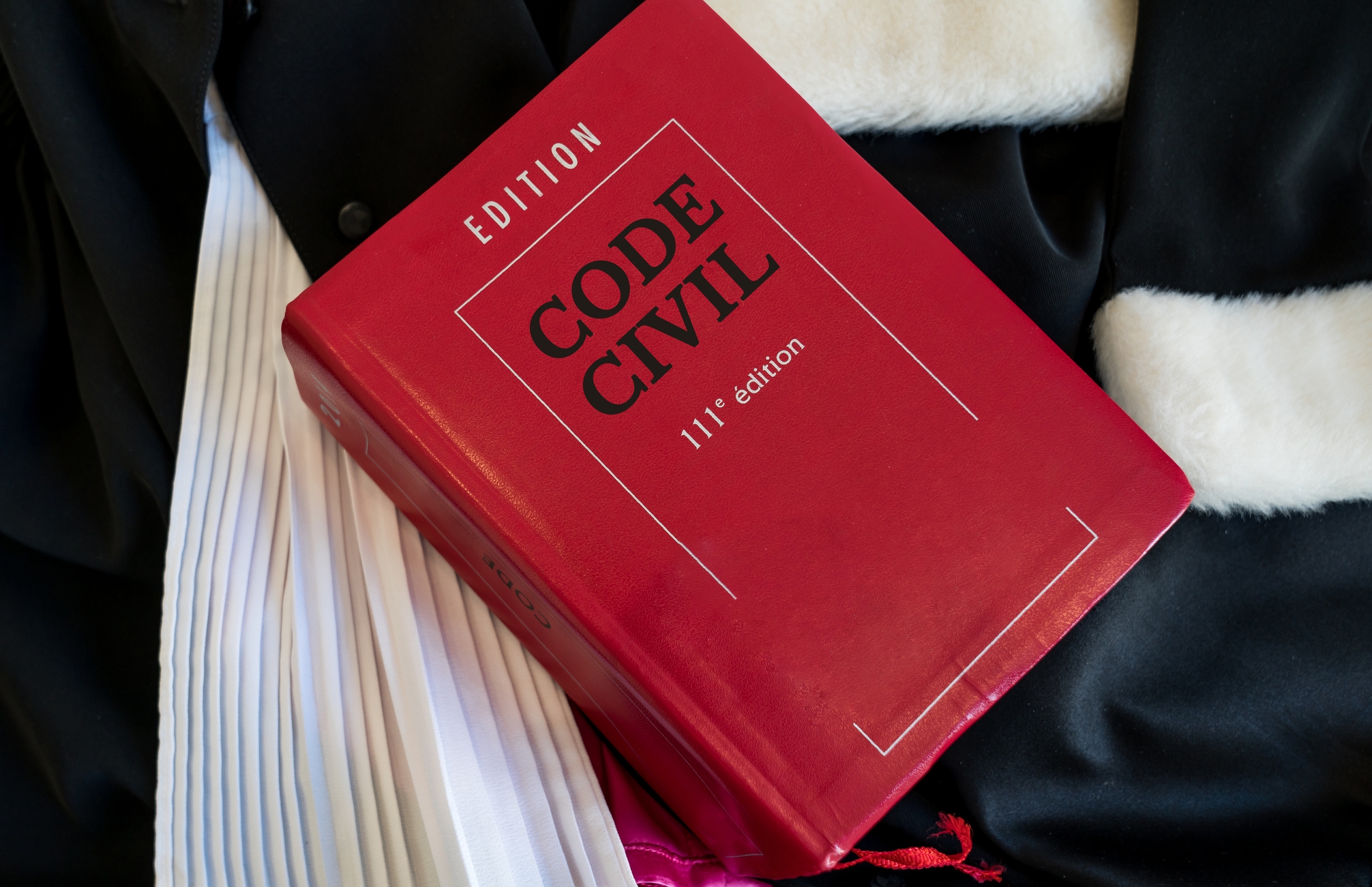La place des pères en cas de séparation
Beaucoup de pères sont persuadés qu’en cas de séparation, les mères bénéficient, par la loi ou la volonté des juges, d’une priorité pour obtenir la résidence de leurs enfants auprès d’elles. Cela n’est pas vrai.
Lorsque des parents se séparent, la question de l’organisation de la nouvelle vie des enfants se pose inévitablement. Habiteront-ils chez leur père, chez leur mère, à quelle fréquence verront-ils chaque parent ?
La loi prévoit d’abord que l’autorité parentale appartient aux deux parents jusqu’à la majorité de l’enfant, même en cas de séparation. Elle précise que le juge, lorsqu’il est saisi d’un litige, peut fixer le lieu de résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux. Dans l’énoncé de la loi, aucune priorité n’est donc donnée, ni à un parent, ni à un mode de garde.
En réalité, la question qui se pose au juge n’est pas de savoir qui est le meilleur parent, mais quelle solution préserve le mieux l’intérêt des enfants, en d’autres termes, quel parent sera le mieux organisé, le plus disponible, le plus respectueux de l’autre parent, le plus attentif à l‘équilibre des enfants, au respect de leurs rythmes de vie, de l’organisation de leurs activités scolaires et de loisirs…
Souvent les mères ont une avance dans la plupart de ces domaines, ce qui fait privilégier la fixation de la résidence des enfants auprès d’elles. Mais lorsque les pères se sont investis dans la vie quotidienne de leurs enfants, ils obtiennent la mise en place d’un système de résidence alternée (voir article sur ce point).
Ils obtiennent aussi parfois que la résidence des enfants soit fixée chez eux.
Concrètement, lorsque les parents sont déjà séparés, le juge se réfère à la pratique précédemment mise en place, pour analyser les différents critères qui permettent de dégager ce qui semble être l’intérêt de l’enfant.
Ainsi, des pères ont pu obtenir que la résidence de leurs enfants soit fixée par décision de justice à leur domicile parce que la mère a choisi de partir sans emmener les enfants (une mère contrainte par le père de quitter le domicile sans ses enfants se les verra au contraire confier).
Une mère qui s’établit à une grande distance du domicile du père et rend difficile le maintien de relations personnelles entre le père et les enfants s’expose à perdre la possibilité de garder ses enfants auprès d’elle.
Le juge peut aussi prendre en compte la parole de l’enfant.
Ainsi le juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de Troyes a-t-il pu fixer en 2013 la résidence de 3 enfants, âgés de 14, 11 et 6 ans au domicile du père sur un double motif. Le juge a retenu d’abord que les deux aînés, qui avaient refusé de suivre leur mère lorsqu’elle est partie à plus de 300 km, ont exprimé leur souhait de rester auprès de leur père. Il a décidé ensuite que si la mère a toute liberté pour vivre là où elle le souhaite, elle ne peut vouloir que les conséquences de sa décision et l’expression de sa liberté soient supportées par l’enfant le plus jeune par le biais d’une séparation de la fratrie, séparation dont les enfants souffrent.
La décision de fixer la résidence des enfants au domicile de leur père est donc très clairement fondée sur l’intérêt des enfants qui est d’être entendus dans l’expression de leur désarroi et protégés des choix parentaux qui bouleversent trop profondément leur équilibre de vie.
Il ne s’agit jamais pour un juge de choisir un parent au détriment de l’autre, qui bénéficiera de toute façon d’un droit de visite et d’hébergement. Il s’agit de prendre en compte le point de vue de l’enfant, d’envisager la solution qui l’exposera à moins de souffrance, sans a priori sur les parents.
De la sorte, les pères, qui s’investissent aujourd’hui davantage dans la vie de leurs enfants, ont une place reconnue, qui n’est pas moindre que celle des mères. Il n’est pas rare d’ailleurs de voir des enfants habiter chez leur mère, puis chez leur père, puis éventuellement revenir chez leur mère, en fonction de leur maturité ou des choix de vie des parents.
Le 8 janvier 2014, article rédigé par Maître Isabelle DOMONT-JOURDAIN du cabinet ACG
Dans la même thématique
La procédure de divorce devant le tribunal
La procédure devant le tribunal est envisagée lorsque les époux ne s’entendent pas sur la volonté de se séparer ou sur certains points de leur séparation.
Chaque époux doit avoir un avocat (de deux cabinets différents)
Puis-je obtenir une mesure d'éloignement contre mon conjoint ?
Vous êtes victime de violences de la part de votre conjoint, partenaire, ou même ex-conjoint.
Il n’existe en l’état pas de mesure d’éloignement à proprement parler.
L’éloignement ou plutôt l’interdiction d’approcher peut résulter :
L'obligation alimentaire envers les ascendants
On me réclame une pension pour mon père/ma mère en maison de retraite ou hospitalisée, est-ce normal ?
Dois-je répondre au courrier du conseil départemental qui me demande de déclarer mes revenus afin de déterminer le montant de ma contribution pour mon ascendant ?
La réponse tient en deux mots : obligation alimentaire.
Il s’agit du devoir pour chacun de contribuer à l’entretien de son parent ascendant dans le besoin.
La désolidarisation du compte joint
Il est fréquent qu’un couple ouvre un compte joint.
Si l’existence de celui-ci peut faciliter la vie au quotidien, il peut être également être source de conflits surtout en cas séparation.
NON un enfant de 13 ans ne décide pas de son mode de résidence !
Focus sur l’audition de l’enfant dans les procédures devant le juge aux affaires familiales
Je souhaitais revenir sur ce mythe qui circule certainement sur les réseaux ou internet et que je retrouve souvent dans la bouche de mes clients : « Je viens vous voir, Maitre, car mon fils/fille a 13 ans alors je veux ressaisir le juge aux affaires familiales pour revoir le mode de garde car il ne veut plus aller chez son autre parent ».
Présentation du divorce devant le tribunal
Chaque époux doit avoir son propre avocat.
La procédure débute par une assignation en divorce (acte rédigé par l’avocat)
Cette assignation est apportée à la partie adverse par un huissier de Justice et contient la date de l’audience
Cette assignation comporte :
1/ les demandes au titre des mesures provisoires à savoir :
Divorce ou séparation de corps ?
Les conséquences des violences familiales au sein du foyer sur l'exercice de l'autorité parentale
L'accord parental
Cohabitation et responsabilité civile des parents
L’article 1242 alinéa 4 du Code Civil dispose que « Le père et la mère, en tant qu’ils exercent l’autorité parentale, sont solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux. »
La question se posait de savoir si, dans l’hypothèse où l’enfant mineur résidait au domicile de l’un de ses parents séparés, seule la responsabilité de celui-ci était engagée.