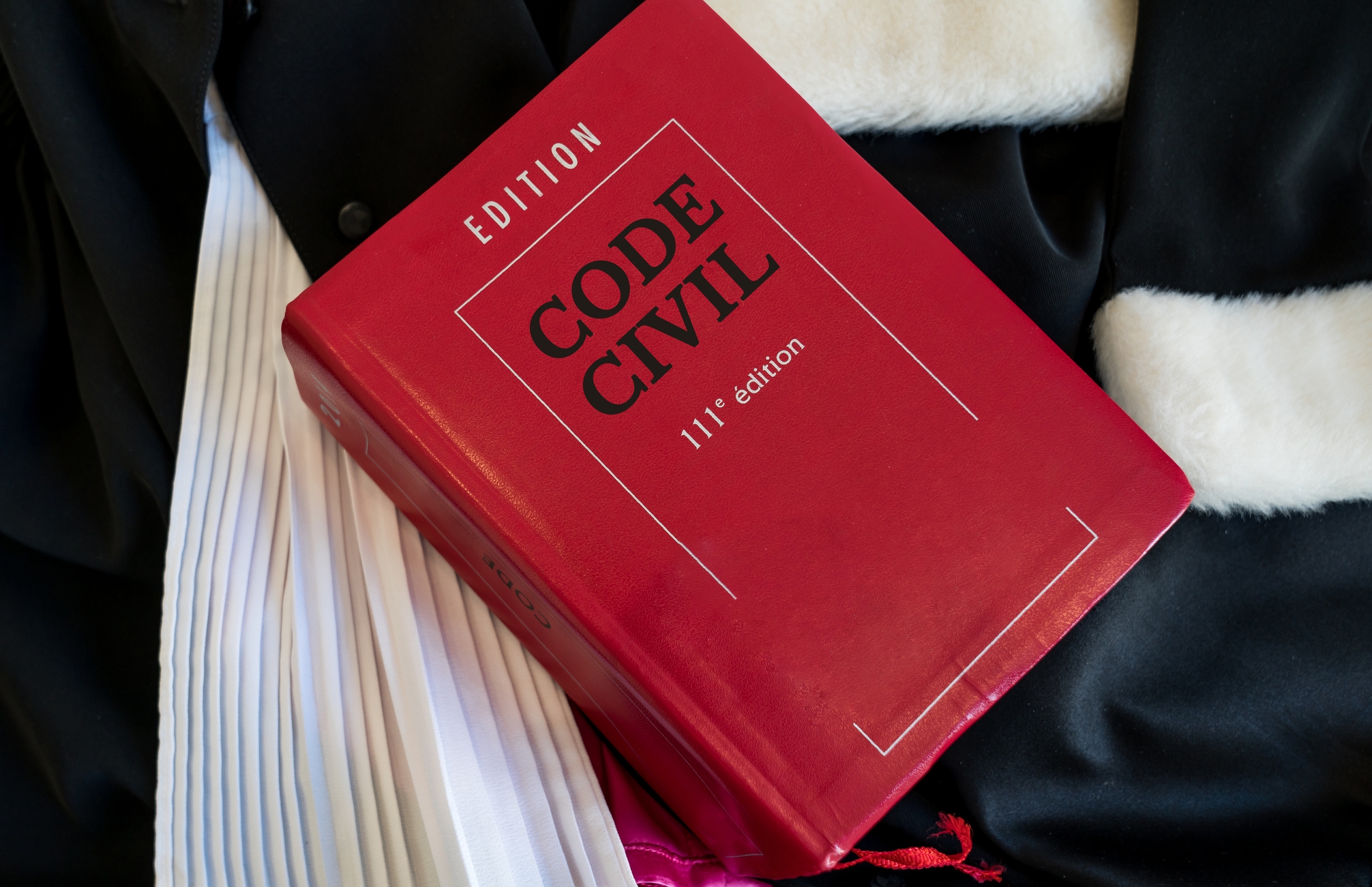La séparation du couple et l’indivision immobilière

L’acquisition en indivision d’un logement peut être un redoutable sujet de tension lors de la séparation du couple car cette dernière nécessite bien souvent la réalisation de comptes entre les coindivisaires.
En effet, il n’est pas rare que l’un des deux ait financé tout ou partie de la part de son coindivisaire avec ses deniers propres et la question qui se pose alors est de savoir s’il peut au moment de la séparation prétendre au paiement d’une créance.
Malheureusement, le droit de propriété ne dépend pas du financement de l’opération. Faute de précision, le bien indivis appartient par moitié à chacun des deux indivisaires.
Toutefois une distinction doit être faite entre le financement par un emprunt ou au moyen d’un apport personnel dans l’hypothèse où le bien acquis ne constitue pas le domicile de la famille.
Si l’une des parties a remboursé l’emprunt souscrit lors de l’acquisition du bien immobilier, ce remboursement est considéré comme une dépense nécessaire à sa conservation. Elle disposera d’une créance contre l’indivision (article 815-13 al1 du CCiv) dont elle pourra se prévaloir lors de la séparation. Il lui suffira d’apporter la preuve que les fonds utilisés lui appartiennent en propre.
En revanche, le financement de l’acquisition par un apport personnel ne peut donner lieu à indemnisation sur le fondement de l’article 815-13 du CCiv. Dans ce cas, cet indivisaire ne pourra se prévaloir d’une créance à l’égard de l’indivision mais à l’égard de son coindivisaires.
Afin d’éviter ce contentieux, il est recommandé d’insérer dans l’acte d’acquisition du bien en indivision, une clause stipulant qu’un des indivisaires a effectué un apport personnel. Ainsi en cas de séparation il pourra récupérer celui-ci sans discussion.
La neutralisation de la créance
La Cour de Cassation s’est attachée à neutraliser le droit à créance des époux par l’obligation de contribuer aux charges du mariage (article 214 cciv). Cette neutralisation s’applique également aux personnes pacsées et aux concubins ; le fondement étant pour les premiers l’aide matérielle et pour les seconds la participation aux dépenses de la vie courante.
En principe, chaque époux doit contribuer aux charges du mariage à proportion de ses facultés c'est-à-dire ses capacités financières.
La jurisprudence considère que le financement du logement de la famille par l’un des époux est constitutif de son obligation de contribuer aux charges du mariage.
Ce principe s’applique également aux personnes pacsées et aux concubins.
La Cour de Cassation admet que le remboursement de l’emprunt ayant permis le financement de l’achat indivis du logement familial constitue une dépense de la vie courante.
Le remboursement du prêt (paiements échelonnés) est considéré comme une contribution aux charges du mariage et non l’apport en capital de fonds personnels.
Afin d’éviter la neutralisation de la créance, l’époux demandeur peut toujours tenter de démontrer que sa contribution aux charges du mariage a excédé sa participation normale au regard de ses capacités financières.
Afin d’éviter cette situation, il est recommandé d’inclure dans l’acte d’acquisition du bien immobilier une clause précisant que les acquéreurs n’entendent pas faire du remboursement de l’emprunt un mode de contribution aux charges de la vie courante Anticiper, c’est éviter d’ajouter à la séparation un contentieux supplémentaire et délicat.
Dans la même thématique
La procédure de divorce devant le tribunal
La procédure devant le tribunal est envisagée lorsque les époux ne s’entendent pas sur la volonté de se séparer ou sur certains points de leur séparation.
Chaque époux doit avoir un avocat (de deux cabinets différents)
Puis-je obtenir une mesure d'éloignement contre mon conjoint ?
Vous êtes victime de violences de la part de votre conjoint, partenaire, ou même ex-conjoint.
Il n’existe en l’état pas de mesure d’éloignement à proprement parler.
L’éloignement ou plutôt l’interdiction d’approcher peut résulter :
L'obligation alimentaire envers les ascendants
On me réclame une pension pour mon père/ma mère en maison de retraite ou hospitalisée, est-ce normal ?
Dois-je répondre au courrier du conseil départemental qui me demande de déclarer mes revenus afin de déterminer le montant de ma contribution pour mon ascendant ?
La réponse tient en deux mots : obligation alimentaire.
Il s’agit du devoir pour chacun de contribuer à l’entretien de son parent ascendant dans le besoin.
La désolidarisation du compte joint
Il est fréquent qu’un couple ouvre un compte joint.
Si l’existence de celui-ci peut faciliter la vie au quotidien, il peut être également être source de conflits surtout en cas séparation.
NON un enfant de 13 ans ne décide pas de son mode de résidence !
Focus sur l’audition de l’enfant dans les procédures devant le juge aux affaires familiales
Je souhaitais revenir sur ce mythe qui circule certainement sur les réseaux ou internet et que je retrouve souvent dans la bouche de mes clients : « Je viens vous voir, Maitre, car mon fils/fille a 13 ans alors je veux ressaisir le juge aux affaires familiales pour revoir le mode de garde car il ne veut plus aller chez son autre parent ».
Présentation du divorce devant le tribunal
Chaque époux doit avoir son propre avocat.
La procédure débute par une assignation en divorce (acte rédigé par l’avocat)
Cette assignation est apportée à la partie adverse par un huissier de Justice et contient la date de l’audience
Cette assignation comporte :
1/ les demandes au titre des mesures provisoires à savoir :
Divorce ou séparation de corps ?
Les conséquences des violences familiales au sein du foyer sur l'exercice de l'autorité parentale
L'accord parental
Cohabitation et responsabilité civile des parents
L’article 1242 alinéa 4 du Code Civil dispose que « Le père et la mère, en tant qu’ils exercent l’autorité parentale, sont solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux. »
La question se posait de savoir si, dans l’hypothèse où l’enfant mineur résidait au domicile de l’un de ses parents séparés, seule la responsabilité de celui-ci était engagée.